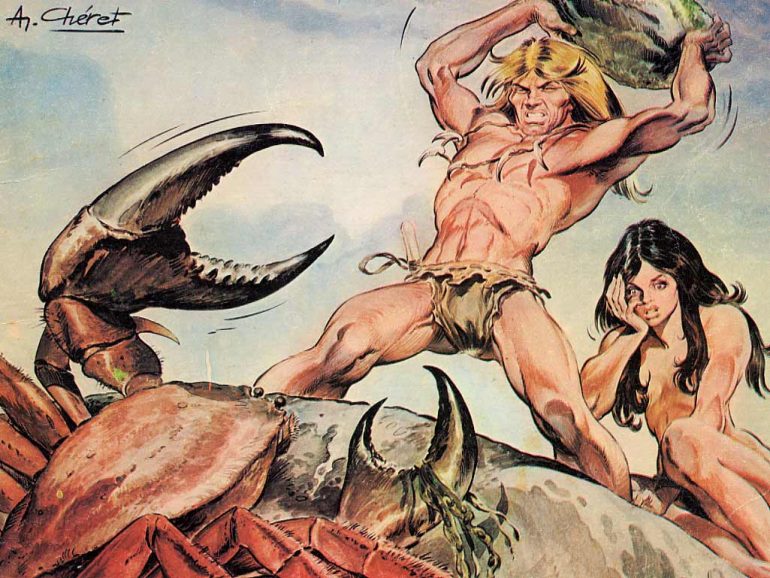« Les femmes sont plus petites que les hommes car elles ont été privées de viande depuis la nuit des temps », titrait L’Obs il y a quelques jours. Une part croissante des médias français se fait l’écho d’une théorie excitante élaborée par une anthropologue sans formation en biologie, Priscille Touraille, selon laquelle la différence de taille et de volume musculaire entre hommes et femmes viendrait d’une privation alimentaire orchestrée par les hommes depuis la nuit des temps sur l’ensemble du globe terrestre. En douze ans d’existence, cette théorie n’a été appuyée par aucun spécialiste en biologie évolutive. Si cette fake news prospère, c’est grâce à l’inculture du grand public -journalistes inclus- en matière de biologie évolutive et parce qu’elle flatte nos pulsions complotistes. Serions-nous, femmes, si fragiles, si irrationnelles, qu’il faille nous épargner les rigueurs d’un discours authentiquement scientifique en nous offrant à la place le doux cocon d’une science de niveau infantile ? Et si nous assistions à l’avènement d’un féminisme obscurantiste ?
Mystification scientifique, unanimité médiatique
La théorie présentée par Priscille Touraille dans sa thèse de 2005 puis dans son livre Hommes grands, femmes petites (2008) repose sur un nombre préoccupant de sophismes, comporte de nombreuses failles logiques, s’appuie sur une présentation tronquée des mécanismes de la sélection naturelle et est faiblement étayée sur le plan factuel.
Comme le remarque la journaliste scientifique Peggy Sastre, en douze années, Priscille Touraille (docteur en anthropologie sociale et non physique) n’a jamais publié d’article en peer-reviewed sur sa théorie du dimorphisme sexuel. Autrement dit, elle refuse de se plier à une procédure élémentaire du débat scientifique : soumettre son travail à l’examen d’un comité de lecture d’une revue scientifique, composé de chercheurs reconnus dans le domaine étudié. La quatrième de couverture du livre de Touraille propose de « renouveler » une « investigation remarquablement gelée depuis le XIXe siècle ». À quoi bon débattre de cette thèse révolutionnaire avec d’autres scientifiques, puisque ceux-ci ne seraient que des dinosaures arque-boutés sur des thèses d’un autre âge ?
On comprend aisément les craintes de l’auteure : lorsque des scientifiques qualifiés en matière de biologie évolutive et de génétique s’expriment sur la thèse du dimorphisme sexuel culturellement induit, ils la démontent intégralement, comme dans ce magistral article du biologiste Jerry Coyne.
Le travail de Priscille Touraille porte le sceau prestigieux du CNRS mais seul le volet culturel de sa thèse a pu être évalué. La seule chose qui ait pu être validée dans sa thèse, c’est qu’il existe quelques tribus africaines et asiatiques dans lesquelles la sous-alimentation des femmes est probablement en partie culturellement instituée, et que quelques sources parcellaires, extrapolées et sorties de leur contexte, peuvent laisser supposer que peut-être, un jour, quelque part en occident, cette pratique ait pu avoir lieu.
Passons sur les tours de passe-passe permettant à Touraille de tisser ses amalgames ethnographiques. Le problème principal reste entier. Priscille Touraille entend prouver que le dimorphisme de taille entre hommes et femmes est « l’indice de sélections non naturelles constituées par une entreprise de catégorisation sociale millénaire : le genre ». Le cœur de sa démonstration relève purement de la biologie. Sa théorie ne tient que si elle arrive à prouver que la différence de taille n’est pas naturelle.
Or, la thèse a été dirigée par l’ethnologue Françoise Héritier et le livre a été préfacé par l’historien Dominique Pestre, qui ont tous deux en commun de n’avoir jamais publié quoi que ce soit dans le domaine de la biologie évolutive. Nulle trace de biologistes non plus dans les jurys qui lui ont décerné le Prix de la Ville de Paris et le Prix Le Monde de la recherche universitaire en 2007.
Dans un article de 2015 cosigné avec trois autres auteurs, Priscille Touraille évoque sa théorie du dimorphisme sexuel non plus comme une « hypothèse », mais comme une vérité établie. « L’idée (…) selon laquelle les hommes doivent manger plus de protéines que les femmes » est « fausse du point de vue des théories récentes des sciences de la nutrition », affirme-t-elle. Quelle référence cite-t-elle pour étayer son propos ? Sa propre thèse, validée par aucun spécialiste des « sciences de la nutrition » ni aucun biologiste. On frise le canular. C’est à se demander si Jean-Baptiste Botul n’a pas présidé le jury de thèse.
En somme, cette thèse multimédaillée n’a pas de validité scientifique. Ou du moins, pas beaucoup plus qu’une thèse de biochimie encensée par un jury d’historiens de la littérature slave.
[Mise à jour : Priscille Touraille a publié en 2008 une présentation de sa thèse du dimorphisme, co-signée avec un authentique spécialiste de la biologie évolutive, Pierre-Henri Gouyon. Mais ce texte a un statut de pré-publication, raison pour laquelle il ne figure pas dans la liste des « articles dans revues à comités de lecture » mise à jour en avril 2017]Pourtant, la théorie de Touraille est reprise sans remise en question par Nora Bouazzouni dans son récent ouvrage Faiminisme, quand le sexisme passe à table, qui jouit en ce moment de relais médiatiques aussi nombreux que complaisants. Malgré son évidente faiblesse scientifique, d’importants médias français publics ou subventionnés (Le Monde, France Inter, La Croix, RFI, Arte, Les Inrocks, Le Parisien et L’Obs) la relayent à toutes les sauces sans y apporter la moindre contradiction, sans interroger d’autres spécialistes, quand ils ne la présentent pas carrément sous l’aspect d’un fait établi, comme dans Libération ou dans cette récente vidéo de Franceinfo qui comptabilise 403 000 vues en quatre jours. On peut discuter de la part de naïveté, de paresse intellectuelle ou d’inculture scientifique qui explique cette unanimité médiatique, mais ce qui est certain, ce que nous avons affaire à une fake news, une vraie.
« Chez les mammifères, la femelle est souvent plus grande que le mâle » : faux
C’est l’argument qui revient toujours en premier. C’est aussi le plus grossièrement faux. « Souvent chez les mammifères on voit que la femelle est plus grande, plus grosse, que le mâle ! », assène Nora Bouazzouni en ouverture de sa vidéo de présentation de son livre (elle s’est depuis défendue en accusant « le montage »). « Chez le plus grand animal vivant sur terre, la baleine bleue, la femelle dépasse toujours le mâle ! », s’enthousiasment France Inter et Arte. Dans le règne animal, le mâle est majoritairement plus petit que la femelle, mais chez les mammifères, c’est le mâle qui est plus grand que la femelle dans l’écrasante majorité des cas. Les dimorphismes inverses (baleine bleue, hyène tachetée…) sont des exceptions rares. Dans la famille des primates, à laquelle appartiennent l’homme et son proche cousin le chimpanzé, le mâle est toujours plus grand et plus gros que la femelle.
L’exemple de la baleine bleue est séduisant (le roi des animaux est en fait une reine !) mais c’est un sophisme de la généralisation abusive. Les cétacés sont une exception parmi les mammifères, et même parmi les cétacés, de nombreuses espèces présentent un mâle plus gros que la femelle (comme chez la baleine blanche, l’orque, le narval, le cachalot, et plusieurs espèces de dauphin).
« Nous avons été privées de nourriture, et ce, depuis la nuit des temps » : faille logique
Dans son livre, Priscille Touraille imagine une société humaine originelle « dans laquelle les hommes seraient en majorité plus petits que les femmes » (ou de même taille). La petite taille et les petits muscles des femmes seraient l’aboutissement d’un long processus de privation de nourriture orchestré par les hommes. Or, comment diable les hommes auraient-ils pu nous empêcher de manger à notre faim, si ce n’est en nous dominant physiquement ? Dans la quasi-totalité des sociétés humaines présentes et passées, ce sont les femmes qui préparent la nourriture du quotidien. Il faut que nos aïeules préhistoriques aient été bien bêtes pour se laisser dépouiller par une bande de nains à pénis.
Ou alors, on peut privilégier l’hypothèse la plus probable et la plus consensuelle, selon laquelle les femmes mangent moins que les hommes car leurs besoins caloriques sont moindres que ceux des hommes. Quand elles sont enceintes, leurs besoins augmentent, donc elles doivent manger beaucoup plus.
D’ailleurs, de quoi les femmes ont-elles manqué au fil des millénaires à cause des hommes ? On ne sait pas trop. Entre Priscille Touraille, Nora Bouazzouni et Françoise Héritier, les versions varient d’une interview ou publication à l’autre. Tantôt ce sont les carences en fer, tantôt celles en protéines, tantôt celles en graisse qui sont sont responsable de la diminution artificielle du corps féminin. Tantôt c’est la taille, tantôt c’est la force, tantôt c’est la masse musculaire, tantôt c’est l’ossature qui cristallisent les débats. Boarf, nous ne sommes plus à ça près.
De Françoise Héritier à Nora Bouazzouni en passant par Priscille Touraille, tous les exemples de sociétés mis en avant montrent des femmes subissant un contrôle alimentaire rapetissant. Elles insistent toutes trois sur l’universalité de ce phénomène et sur le fait que la petitesse des femmes est un désavantage évolutionnel. Si l’on va au bout de leur argument, soit 100% des sociétés humaines ont de tous temps affamé les femmes (coordination télépathique remarquable !), soit certaines sociétés ont procédé autrement mais on n’en a retrouvé aucune trace. Autrement dit, les petites femmes mal nourries des sociétés inégalitaires peupleraient le monde tandis que les grandes femmes bien nourries des sociétés égalitaires auraient été laminées par l’évolution. Aïe.
Pour Touraille, le dimorphisme homme-femme est le fruit de « sélections non-naturelles ». Mais la distinction naturel/ non-naturel a-t-elle une pertinence sur le plan évolutionnel ? Non. Le cerveau fait partie de la nature, et les artifices qu’il produit aussi. Les transactions sexuelles de bonobos, la cuisine humaine, les rapports de dominations entre hommes et femmes, l’agriculture, la peur chez les Agni N’Denian de Côte d’Ivoire que la consommation de patates par la femme enceinte ne provoque l’étranglement du bébé par le cordon, tout cela relève de l’adaptation (réussie ou non) à des contraintes naturelles grâce à un organe, le cerveau.
« La grande taille diminue la mortalité en couches, donc nous aurions dû être plus grandes si les hommes ne nous avaient pas affamées » : la théorie de l’évolution charcutée
L’argument scientifique central de Priscille Touraille, c’est que si les hommes avaient laissé les femmes manger assez, l’évolution aurait favorablement sélectionné les femmes grandes. La preuve, selon elle ? Plusieurs études montrent que la mortalité en couches est plus fréquente chez les femmes petites que chez les femmes grandes. Être petite implique un bassin plus petit, ce qui peut gêner le passage de la tête du bébé (dystocie osseuse) et rendre l’accouchement mortel pour la mère ou l’enfant.
Mais la petite taille est aussi un avantage : un petit corps est moins coûteux à entretenir sur le plan énergétique qu’un grand corps. En cas de pénurie alimentaire, les petites personnes survivent davantage. La grossesse et l’allaitement étant extrêmement énergivores, la capacité de résistance aux famines est plus cruciale pour les femmes que pour les hommes. Être peu musclée est également un avantage pour résister à une famine. Le muscle consomme de l’énergie même au repos. Au fil des millénaires, l’évolution a privilégié les femmes petites stockant facilement la graisse plutôt que les femmes grandes produisant plus facilement du muscle que des réserves de graisse. Le premier type de femmes a davantage survécu et a davantage été recherché par les hommes.
Les femmes, de leur côté, ont probablement sélectionné leurs partenaires sexuels masculins sur leur capacité à leur fournir de la nourriture et à les protéger des prédateurs, ce dont la taille et la masse musculaire sont d’assez bons indicateurs. Toute la première partie de la thèse de Touraille vise à battre en brèche cette hypothèse. Elle s’appuie pour cela sur une étude de 1975 montrant qu’en Afrique et Nouvelle Guinée où la polygamie est répandue, le dimorphisme sexuel est moindre qu’en Europe où le modèle monogame domine. D’après elle, la compétition entre mâles étant plus âpre dans les sociétés polygames, l’étude de ces sociétés permet d’isoler le poids de la compétition sexuelle dans l’évolution d’un groupe donné. C’est oublier que le mariage polygame eut cours pendant longtemps en Europe (chez les Vikings par exemple) et qu’il n’est pas un indicateur suffisant de compétition sexuelle au sein d’une société. Le climat, les guerres, l’esclavage, la généralisation de la procréation hors-mariage ou encore la division sexuelle du travail peuvent accroître fortement la compétition entre mâles.
En matière de mortalité en couches, la taille du bassin est loin d’être le seul facteur de risque. En écrivant cet article, j’ai interrogé plusieurs sages-femmes sur le sujet. Tous ont été catégoriques : la petite taille d’une femme enceinte ne constitue jamais à elle seule un indicateur de grossesse à risque. La taille de la tête du bébé joue un rôle important, de même que la forme du bassin de la mère.
Bref, on ne peut comprendre l’évolution du corps féminin si l’on présente un trait (ici, la grande taille) comme un avantage absolu. Pour reprendre la formulation de Peggy Sastre au sujet du dilemme obstétrique, « l’accouchement se situe au carrefour de multiples pressions sélectives, bien souvent contradictoires, entre la mère et son enfant ». Une grosse tête accroît les risques pour la mère, mais globalement, l’augmentation du volume de la boite crânienne a joué en faveur de l’espèce humaine. Être petite peut accroître la mortalité en couches, mais diminue les chances de mourir si l’on est enceinte ou allaitante en période de disette.
Autopsie d’une fake news
Les journalistes de Franceinfo, Libération, Le Monde, L’Obs, Le Parisien, France Inter seraient-ils tous de mèche pour nous abuser ? Le plus probable est qu’ils aient réellement cru bien faire et nous livrer une information fiable. Alors, comment une thèse aussi outrageusement non-scientifique a-t-elle pu accéder au rang de marronnier de la presse française ? La montée en mayonnaise de la fake news s’explique par plusieurs facteurs : une inculture scientifique globale poussant à croire sans enquêter n’importe quelle publication d’apparence sérieuse, une quête journalistique d’évangélisation SJW exacerbée par un contexte de guerre de l’information sur les réseaux sociaux et une fanatisation des féministes par les études de genre.
Vous vous souvenez de cette histoire de baleine bleue ? Ni dans le documentaire d’Arte, ni dans aucun des articles, chroniques et vidéos relayant la thèse de Touraille, il n’est rappelé que les femelles sont plus petites chez la plupart des mammifères et chez tous les primates. Jamais. Cette information se vérifie pourtant en moins de 2 minutes sur Wikipedia si l’on n’est pas capable de lire un article scientifique.
Ironie de l’histoire : la plupart des médias qui ont participé à la propagation de la fake news sur la taille des femmes sur les réseaux sociaux à grands coups de titres racoleurs sont ceux qui s’indignent du développement des fake news et s’inquiètent de notre entrée dans l‘ère post-vérité. France Inter s’interroge sur les moyens de « combattre les fake news », Franceinfo, de même que L’Obs, nous alerte sur « les ravages » des fake news, « jamais vérifiées, souvent gobées« , Le Monde a lancé Décodex, outil dédié à « dénicher les rumeurs, exagérations ou déformations ».
De même que n’importe qui peut taper « taille primates mâles femelles » sur Google, n’importe qui peut vérifier le CV de Priscille Touraille et Nora Bouazzouni pour constater qu’elles n’ont aucune qualification en biologie. La déontologie journalistique impose de croiser un minimum ses sources, ce qui permet, par exemple, de voir que telle théorie de la biologie humaine n’est approuvée par aucun biologiste sérieux sur terre.
Sauf que la thèse de Touraille porte un estampillage scientifique. Elle a soutenu sa thèse au CNRS et a été encensée par sa directrice de thèse Françoise Héritier, directrice d’études à l’EHESS et successeur de Claude Lévi-Strauss au Collège de France. La crème de la crème. Elle a reçu deux prix, souvenez-vous ! Sauf que le Prix Le Monde de la recherche universitaire « valorise des travaux de thèse de chercheurs francophones, susceptibles d’influencer notre environnement scientifique, économique et social ». Pas les travaux les plus valides. Quant au Prix de la Ville de Paris pour les études de genre, il vise à « promouvoir les politiques d’égalité et contribuer à la diffusion des connaissances sur ces sujets« , pas à faire avancer la science, et encore moins la biologie humaine. Ce sont les bonnes intentions qui sont récompensées, pas la qualité objective des productions scientifiques. Si les journalistes ont relayé avec un tel enthousiasme la thèse du dimorphisme sexuel culturellement induit, c’est en grande partie parce que certaines institutions de la recherche scientifique française ont tendance à communiquer de manière floue ou lacunaire.
Deuxième étape de la mystification scientifique : la diffusion par Arte en 2013 d’un documentaire réalisé par Véronique Kleiner, destiné à présenter la théorie de Touraille. Ce qui est remarquable, c’est que parmi les divers experts en biologie, paléoanthropologie et endocrinologie interrogés, aucun ne valide vraiment cette thèse. Les scientifiques répondent à des question générales sur le dimorphisme sexuel et des extraits de leurs réponses jalonnent le film. La magie du montage crée un trompe l’œil de collégialité scientifique, le tout placé sous le haut patronage de Françoise Héritier, à qui la parole est abondamment donnée. Cerise sur le gâteau : la voix-off est assurée par l’humoriste féministe Sophia Aram.
Enfin, ce qui a actionné la pompe à clics auprès du grand public, c’est que tous les ingrédients d’une bonne théorie du complot sont réunis : défiance envers la communauté scientifique, rhétorique de la révélation (« une théorie révolutionnaire »), rejet sans examen sérieux des hypothèses les plus solides au profit d’une argumentation alambiquée, subjectivité déguisée en objectivité, mise en avant des « preuves » les plus séduisantes même si elles sont les plus fausses, accusations simplistes visant à pointer du doigt un groupe de personnes tirant les ficelles à travers les continents et les siècles pour nuire à un autre groupe de personnes, recours à des stéréotypes grossiers (l’homme puissant et malveillant qui opprime la gentille femme n’aspirant qu’à bâtir une société juste, vegan et sans gluten), usage flagrant de cette théorie pour galvaniser un groupe politique précis (les féministes).
La responsabilité individuelle de Françoise Héritier n’est pas à négliger. Dans son interview-testament de novembre accordée au journal Le Monde, elle témoignait avec une ferveur quasi-religieuse de sa foi en la thèse de son étudiante :
« Même cette dysmorphie [sic] a été construite ! [Priscille Touraille] a travaillé sur ce sujet et elle montre que toute l’évolution consciente et voulue de l’humanité a travaillé à une diminution de la prestance du corps féminin par rapport au masculin. Depuis la préhistoire, les hommes se sont réservés les protéines, la viande, les graisses, tout ce qui était nécessaire pour fabriquer les os. Alors que les femmes recevaient les féculents et les bouillies qui donnaient les rondeurs. C’est cette discordance dans l’alimentation – encore observée dans la plus grande partie de l’humanité – qui a abouti, au fil des millénaires, à une diminution de la taille des femmes tandis que celle des hommes augmentait. Encore une différence qui passe pour naturelle alors qu’elle est culturellement acquise. »
Passons sur le lapsus de Françoise Héritier, qui confond dimorphisme sexuel (différence hommes-femmes) et dysmorphie (anomalie de la forme d’un organe – nos corps de femmes perçus comme des anomalies). Ce qui est sidérant, c’est son absence totale de distance et de nuance critique. Intellectuelle chevronnée, Françoise Héritier commet sans sourciller une grave erreur logique : de l’existence d’une construction sociale, elle infère l’inexistence d’un phénomène naturel. Ce qui importe, quitte à en passer par un raisonnement circulaire, c’est de marteler que la différence la plus évidente entre hommes et femmes – la différence physique – n’est pas du tout naturelle. Le fantasme de la page blanche est ici palpable : Héritier voit les corps comme des pages blanches que le patriarcat aurait maculées d’atrocités inégalitaires. Peu importe que la démonstration de Touraille ne tienne pas debout ni ne soit scientifiquement valide. Il faut la soutenir, la présenter pour vraie, parce que les intentions de Tourailles sont bonnes, vont dans le sens de la doxa féministe. Ce qui compte, c’est que Touraille nous dise ce que nous voulons entendre, à savoir que nos faiblesses physiques sont des injustices construites de toutes pièces par les hommes. En cela, le buzz Touraille est un grand moment d’obscurantisme féministe : on promeut une sous-science parce qu’elle est conforme à notre foi politique et l’on disqualifie des travaux scientifiques solides pour leur non-conformité au dogme de la construction sociale toute-puissante. Quitte à en passer par une opération de blanchiment académique consistant à faire valider une théorie d’anthropologie physique par des experts de l’anthropologie sociale.
Distribuer des médailles et offrir une publicité médiatique énorme à des travaux scientifiques de mauvaise qualité, au nom du féminisme, ce n’est pas rendre service aux femmes. Quoi de plus infantilisant pour une femme scientifique que d’être récompensée pour ses bonnes intentions plutôt que pour la qualité de son argumentation ?